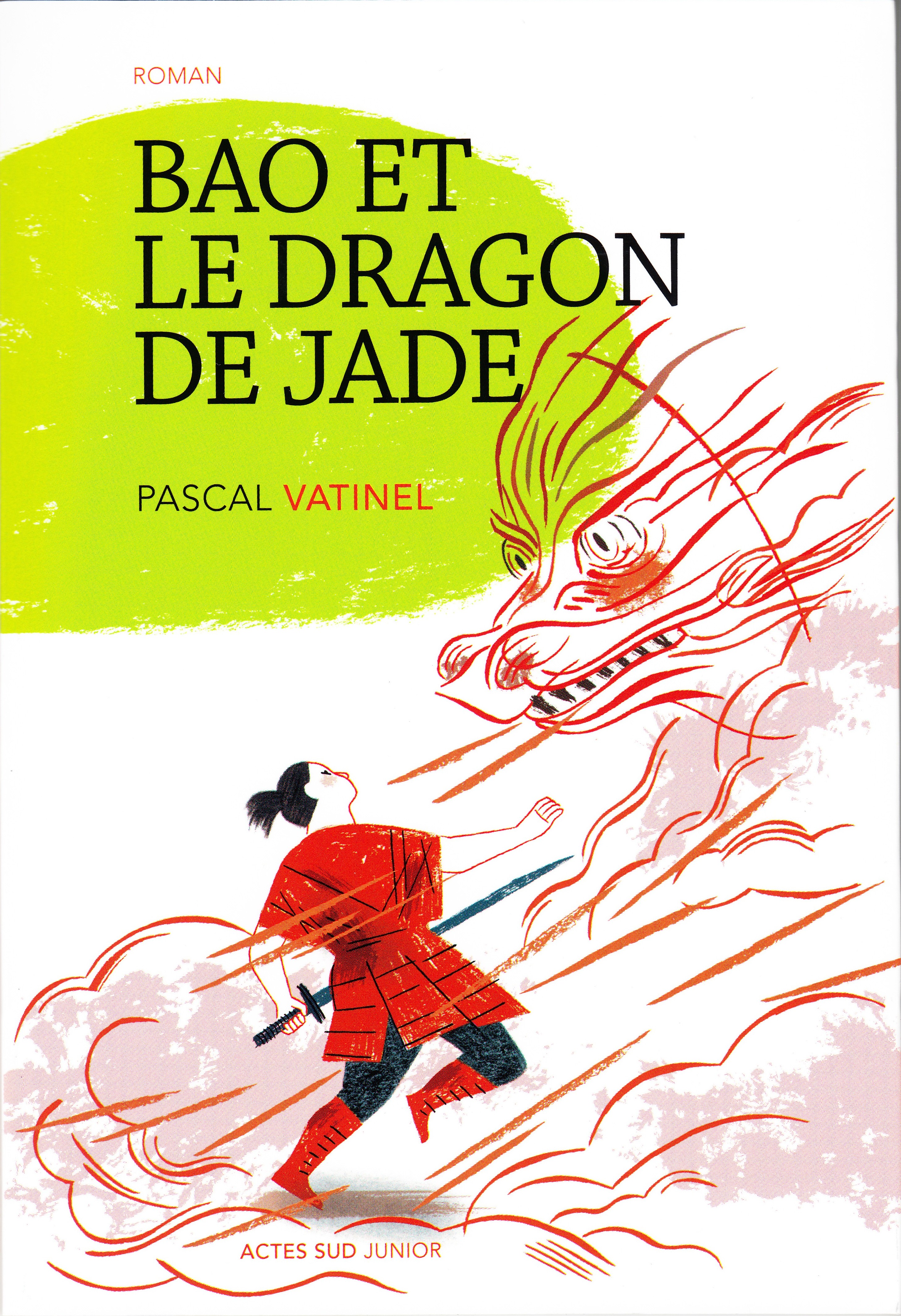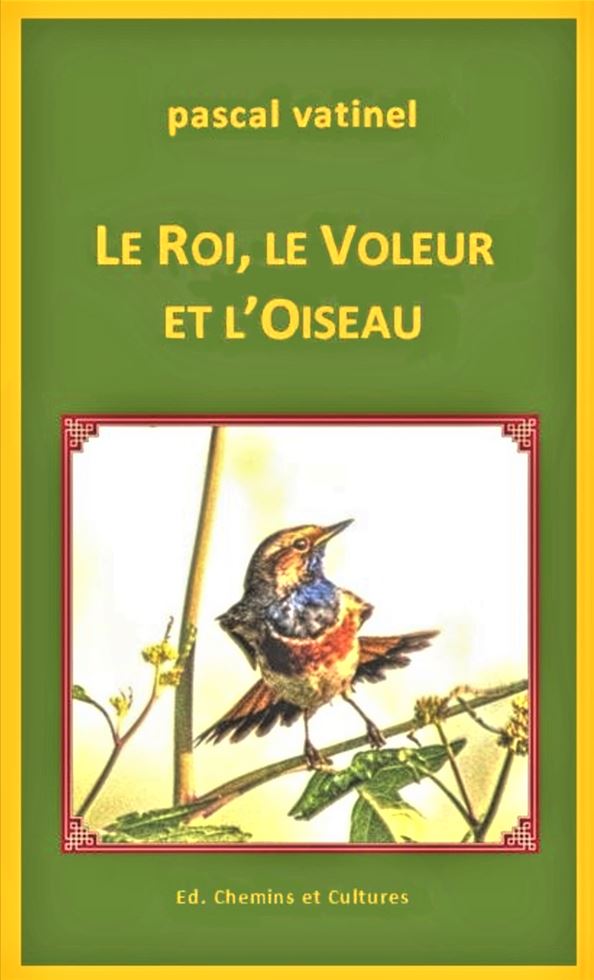|
De quel « An quarante » parle-t-on ?
Vous connaissez sans doute l’expression « S’en ficher comme de l’an quarante ». Du moins en comprend-on le sens, même si l’on n’en devine pas toujours l’origine.
La clé de cette énigme tient peut-être en l’existence (passée) d’un certain Louis-Sébastien Mercier, dont je dois la découverte à un ami cher et fidèle, me parlant récemment de Mercier comme l’un des tout premiers auteurs français de littérature d’anticipation. Ma curiosité fut d’autant plus excitée en apprenant que ledit Mercier avait écrit un ouvrage intitulé « L’An 2440, rêve s’il en fut jamais », en l’an de grâce… 1771 !
Comment, en plein Siècle des Lumières, un auteur pouvait-il se représenter le 25ème siècle ? La Révolution, l’Empire, la révolution industrielle et les transformations profondes de la société qui s’en suivirent, n’avaient pas encore eu lieu. Mercier était-il en mesure d’imaginer l’informatique, la robotique, la société de loisirs et de consommation, les armes, les moyens de contrôle et de pouvoir, la sur-communication et la sous-information… de notre monde moderne ? D’ailleurs, aujourd’hui en 2022, qui serait vraiment capable de prédire ce que sera notre monde dans seulement vingt ans (2040) ?
Me voici aussitôt plongé dans la biographie de Louis-Sébastien Mercier, et sa très longue bibliographie, dont L’An 2440, rêve s’il en fut jamais, pour tenter de découvrir la vision de cet homme hors du commun. Tellement hors du commun que mon ignorance à son sujet m’a couvert de honte. Romancier, dramaturge, essayiste, philosophe, critique littéraire, journaliste ; une trentaine de pièces de théâtre à son actif ; une renommée européenne ; inspirateur de Goethe et de Schiller ; homme politique engagé n’hésitant pas à traiter Robespierre et sa « clique » de représentants de l’ignorance, ni à voter pour la mise en accusation de Marat ; etc. Bref, un auteur incroyablement prolixe et une œuvre très diversifiée. Pourtant, dans le même temps, sa biographie évoque un philosophe qui se juge d’évidence génial, mais dont les conceptions restent marquées par les errances auxquelles ce même siècle des Lumières tente justement d'échapper. Religion, monarchie, place des femmes reléguée à l’arrière-plan, sont des idées que Mercier continue de défendre, autant qu’il attaque celles des autres penseurs (Voltaire et Descartes en tête) ou celles de savants tels que Newton et Copernic dont il remet en cause, par principe, les découvertes. Quant à ses positions sur une éducation accessible à tous, elles sont aux antipodes de celles que développera plus tard un certain Jules Ferry.
Mais alors, quid de L’An 2440, rêve s’il en fut jamais ? Quel monde dessine la grande utopie imaginée par Mercier ? Les amateurs d’Issac Asimov, les fans de Philip K. Dick, les adorateurs de Ray Bradbury resteront sans doute sur leur faim à la lecture de l’ouvrage de Mercier. Pas de Lois de la robotique ni de règne des supercalculateurs ; pas davantage de Big brother ni de voyages interstellaires. Il s’agit plus « simplement » de la peinture d’une société idéale (un « Meilleur des mondes », mais très différent dans la forme et le fond de celui décrit par Huxley), où règnent la raison, la paix, la justice, et de laquelle toute forme d’oppression aurait disparu. En résumé, le rêve de tout bon philosophe, selon la définition que lui donne Mercier. Selon les extraits et résumés que j’ai pu consulter, Mercier n’imagine pas de réelle révolution (pas telle que l’envisage un Robespierre), mais plutôt une transformation de la société, dans laquelle il suffirait que le Roi s’intéresse davantage au bien-être de son peuple plutôt qu’à ses plaisirs personnels et à ses délires architecturaux (délires communs, il est vrai, à un grand nombre de monarques, empereurs et dictateurs, dans toute l’histoire de l’humanité jusqu’à nos jours). Le propos de Mercier, plus qu’un témoignage sur la société dans laquelle il vit, est un appel, voire un guide, à l’attention de ceux qui ont pour vocation de diriger une nation.
Quoi qu’il en soit, cela reste l’un des tous premiers romans d’anticipation (avec une véritable projection dans le temps) d’un auteur français. Et toute utopie est digne d’intérêt pour les esprits curieux.
Utopie et dystopie constituent le corps même de la littérature d’anticipation. Mais il apparaît clairement que l’évolution de la réalité politique et sociale à travers le monde a davantage inspiré les principaux auteurs du genre à n’imaginer le futur qu’à travers la dystopie. Pour n’en citer que quelques-uns parmi les plus fameux, la chronologie nous impose de commencer par H. G. Wells qui, en 1910, publie The Sleeper Awakes (Quand le dormeur s'éveillera) dont le héros, à l’instar de celui de Louis-Sébastien Mercier dans L’An 2440, se réveille après un long sommeil de plus de deux cents ans. Sans doute influencé par les rapides progrès scientifiques de son temps, Wells donne libre cours à son imagination pour dépeindre une Londres soumise à de profondes transformations.
Mais celui qui ouvre véritablement le bal de la littérature dystopique est sans nul doute Aldous Huxley, avec son mondialement connu Meilleur des mondes, paru en 1932. Il y décrit un monde futur géré par l’eugénisme, où l’ordre règne par le plaisir, la satisfaction et le bonheur que chacun ressent en tenant la place et le rôle pour lequel il a été génétiquement programmé.
En 1943, René Barjavel signe Ravage, un roman post-apocalyptique dans lequel l’homme se trouve soudain privé des ressources technologiques telles que l’électricité, et doit réapprendre à vivre selon d’autres modèles.
Viendront ensuite deux œuvres également « essentielles » : 1984 (et son fameux Big Brother), publié en 1949 par George Orwell, puis l’autodafé évoqué dans Farenheit 451 signé en 1953 par Ray Bradbury.
La suite serait encore longue, mais ne nous révèle toujours pas l’origine de l’expression « S’en ficher comme de l’an quarante » ni son lien avec Louis-Sébastien Mercier. La réponse est pourtant simple, du moins si l’on en croit certaines « autorités en la matière », selon lesquelles nous la devons aux royalistes de cette fin du 18ème siècle, et des débuts de la révolution, qui boudèrent sans équivoque les thèses émises par Mercier dans son utopiste L’An 2440, rêve s’il en fut jamais. Preuve, s’il en était besoin, que la littérature d’anticipation peut marquer par bien des façons la réalité de notre monde présent et… à venir !
À lire et à relire : L’An 2440, rêve s’il en fut jamais (1771) Louis-Sébastien Mercier La Découverte Quand le dormeur s'éveillera (1910) H. G. Wells Le Castor Astral Le meilleur des mondes (1932) Aldous Huxley Pocket Ravage (1943) René Barjavel Folio 1984 (1949) George Orwell Folio Farenheit 451 (1953) Ray Bradbury Denoël Publié le 23/10/2022
<< Je suis en colère >>
Comment ne pas partager la colère et l’indignation de Brigitte Gothière, co-fondatrice de l’association L214 ? Voici ce qu’elle écrit dans un courriel daté d’aujourd’hui :
« Je suis en colère. » « Un amendement au projet de loi de finances pour 2023 a été adopté cette semaine en commission des finances de l'Assemblée nationale. Son but ? Priver de réduction d'impôt les dons « aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d'actes d'intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ». Il sera débattu dans les prochains jours en séance plénière. Cet amendement révoltant a 2 objectifs :
Pour le plus grand bonheur des industriels de la viande et de la FNSEA, à la manœuvre pour faire taire toute critique du modèle agricole productiviste… Les intrusions dans les élevages, au cœur de cet amendement, sont déjà interdites et réprimées par le Code pénal. Cet amendement est juste une tentative de plus d’entraver le travail des associations en les privant de leurs moyens financiers. L214 a même été citée nommément ! Les images qui dénoncent le traitement des animaux élevés et tués pour l'alimentation sont clairement visées : empêcher la diffusion de la réalité est un impératif pour les filières viande. Nous ne nous laisserons pas faire. »
Décidément, si les gouvernements précédents ne se montraient guère actifs en matière de mesures environnementales et pour légiférer sur le respect de la vie animale, le gouvernement en place va beaucoup plus loin… dans le sens inverse ! Après les nombreuses et scandaleuses mesures prises en faveur des chasseurs, des élevages intensifs, des marchands de produits toxiques… le voilà qui s’attaque aux lanceurs d’alerte, malgré l’opinion très favorable à leur endroit de la majorité de la population européenne. Il est de plus en plus difficile de croire que l’argent n’aurait pas d’odeur. Publié le 10/10/2022
Un petit poisson, un petit oiseau s’aimaient d’amour tendre…
Le titre de mon dernier roman paru il y a quelques jours, Le Roi, le Voleur et l’Oiseau, comme celui d’un de mes derniers polars, Le chant des galahs, confirme à ceux qui avaient déjà consulté mes Carnets de voyage (présentés sur ce site) mon intérêt marqué pour la faune sauvage en général, et les oiseaux en particulier.
C’est ce même intérêt qui explique l’étrange (et désagréable) impression ressentie en septembre dernier, lors de ma traversée des Vosges « en solitaire » (randonnée par ailleurs merveilleuse du fait de la beauté de cette région), au cours de laquelle je n’ai pu entendre que très peu de chants d’oiseaux. Beaucoup de prés et de forêts traversés sans en apercevoir la queue d’un, à l’exception de rares éperviers, mésanges, pics épeiches… et, bien sûr, quelques cigognes ainsi que des oies dans les basses-cours alsaciennes, en cours d’engraissement pour les fêtes à venir. Il faut dire aussi que le « chant » des fusils de chasse était, lui, très présent certains jours.
Une amie, photographe animalière (à qui je dois le cliché qui m’a permis d’illustrer la couverture du dernier Fleur de Printemps), effectuait dans le même temps une randonnée en Corse. Elle me dit avoir fait le même constat : une faune aviaire anormalement absente !
Ces observations de terrain sont d’évidence conformes au rapport publié il y a une semaine par l’ONG BirdLife. Une étude mondiale qui fait froid dans le dos (et pas seulement parce qu’elle confirme, elle aussi, les effets négatifs du « réchauffement » climatique :). Selon cette étude, une espèce aviaire sur huit est aujourd’hui menacée d’extinction, tandis que 50% des espèces présentes sur la planète connaissent un déclin continu. Ce constat s’est encore aggravé depuis 2018, où il ne s’agissait alors « que » de 40%. Birdlife précise à ce sujet : « Les déclins ne se limitent pas aux espèces menacées et rares. Les populations de certaines espèces communes et largement répandues connaissent aussi un déclin rapide ».
On sait que la chasse est une des causes de cette situation, mais ce n’est pas la plus importante. La prolifération des chats partout dans le monde est un facteur plus grave encore. Rappelons que c’est l'un des rares prédateurs (avec l’homme) qui ne tue pas que pour manger, mais aussi pour « s’amuser ». Le changement climatique joue également son rôle, mais moins que certains modes d’agriculture intensive et d’exploitation forestière (dont les impacts sont très visibles lorsque l’on pratique la randonnée).
A l’instar de toute la faune sauvage, les oiseaux sont victimes de l’activité humaine qui conduit à la perte de leurs habitats et à la diminution constante de leurs ressources alimentaires. J’ai, pour ma part, beaucoup de mal à imaginer un monde duquel le chant et la présence des oiseaux seraient exclus. Publié le 10/10/2022
Quand les légendes rattrapent la réalité
À propos de la série de légendes de Fleur de Printemps, dont le dernier opus est présenté dans le précédent billet, l’actualité scientifique nous ramène étrangement au tout premier de ces romans (tous publiés chez Actes Sud, dans la collection Cadet) : Bao et le dragon de jade.
Paru la première fois en 2010, ce petit ouvrage a beaucoup compté pour moi et a joué un rôle prépondérant dans ma modeste carrière d’écrivain. Il s’est vendu à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires et a été réédité à plusieurs reprises, après avoir reçu un excellent accueil dans le milieu de l’enseignement et des médiathèques. Il a également été sélectionné, en 2012, pour le très fameux Prix des Incorruptibles, qu’il a emporté, après que plus de 80 000 élèves aient voté au plan national. Inutile de préciser que, pour un premier partenariat avec Actes Sud, nous avions, eux et moi, de bonnes raisons de nous réjouir et de poursuivre notre aventure ensemble.
Dans l’histoire, le jeune héros est confronté à un (supposé vilain) dragon qui a pour fâcheuse habitude de se nourrir de pierres de jade ! L’idée, même si elle se justifie très bien au plan de la symbolique traditionnelle chinoise, avait tout de même de quoi surprendre un jeune public peu versé dans les subtilités de la Chine ancienne. J’ai pourtant découvert récemment que cette même idée était au cœur des deux derniers albums de Blake et Mortimer, parus en 2018/2019 sous le titre La Vallée des Immortels. À cette différence près que les auteurs ne « nourrissaient » plus leurs dragons avec du jade, mais avec des émeraudes ! Aujourd’hui, l’actualité scientifique semble aller dans le même sens ! Des œufs géants de dinosaures viennent en effet d’être découverts dans la province du Liaoning, en Chine, et ils étaient emplis de… cristal !
Il s’agirait plus précisément de cristaux de calcite, un minéral souvent présent dans les œufs de dinosaures et de leurs proches cousins, les oiseaux. Or, faut-il le rappeler, ce sont aussi les dinosaures (ou plutôt les découvertes de nos ancêtres les concernant) qui ont donné naissance à cet animal mythique qu’est le dragon ! Plus intéressant encore, cette découverte s’est faite dans le Liaoning, qui est précisément la province dans laquelle se situe la légende de… Bao et le Dragon de jade !
Décidément, les voies de la création sont impénétrables (ou presque) Publié le 03/10/2022
Nouvelle parution : Le Roi, le Voleur et l'Oiseau
Je suis heureux de vous annoncer la parution de : Le Roi, le Voleur, et l'Oiseau.
Vous en trouverez la description dès la page d'accueil de ce site, rubrique "jeunesse", et en cliquant sur la photo de couverture.
Il s'agit d'une nouvelle histoire de Fleur de Printemps, où l'on retrouve donc cette petite chinoise à l'esprit si vif, et curieuse de tout, en compagnie de son grand-père Lao Sheng, toujours désireux de satisfaire à cette curiosité en usant de toute son érudition sur les traditions de son pays.
Dans le cadre somptueux du parc du Temple du Ciel, à Pékin, le vieil homme répond aux questions de Fleur de Printemps à propos des gens qu'ils croisent et qui promènent leurs oiseaux en cage. Admirative de la beauté de leurs protégés, et surtout de leurs chants, elle s'inquiète tout de même du fait qu'ils soient ainsi privés de liberté. Le bonheur de leur maître n'est-il pas égoïste et à leur détriment ? Lao Sheng lui présente alors un de ses amis, qui possède lui aussi une cage. Il lui rapporte les interrogations de sa petite fille. Celle-ci n'en croit pas ses yeux lorsque, pour toute forme de réponse, le promeneur ouvre la cage et laisse son oiseau s'envoler ! Fleur de printemps est encore plus ébahie quand, sur un simple sifflement, l'oiseau revient de lui-même dans la cage. Loin de calmer la curiosité de la petite fille, la démonstration n'a fait qu'exciter sa curiosité. Lao Sheng n'a pas d'autre choix, pour y répondre, que de lui raconter l'histoire du roi qui aimait les oiseaux, et de Niao, un jeune garçon, bien décidé à apprivoiser le plus beau de tous pour le vendre à son suzerain. Afin de réaliser son projet, Niao doit franchir nombre d'obstacles et faire preuve d'un grand courage, à commencer par quitter sa famille pour se rendre dans la montagne où il espère rencontrer un homme très étrange dont on dit qu'il sait apprivoiser tous les oiseaux.
A travers cette vieille légende, Fleur de Printemps va découvrir que l'idée de liberté est très différente selon chacun, y compris peut-être, pour les oiseaux !
Note : ce texte est une réécriture complète et approfondie de la toute première Légende de Fleur de Printemps, parue sous ce titre en 2007 aux éditions Bleu de Chine, au format album. L'éditeur ayant hélas déposé son bilan au moment même de cette parution, l'album n'avait pas eu le temps d'être largement diffusé ni donc vivre sa vie. Les récits de la série Fleur de Printemps se sont ensuite poursuivis aux éditions Actes Sud, et sont toujours diffusés :)
Publié le 03/10/2022
Le poids du vivant sur terre
Arte vient de diffuser un excellent reportage (comme toujours), relatant le travail incroyable réalisé par des experts et scientifiques, à propos de… la biomasse de notre planète. Ces hommes et ces femmes étonnants, qui n’ont pourtant rien de « Professeurs Tournesol », se sont posé l’étrange question : « Quel poids représente le vivant sur terre ? » et, plus étrange encore, ont consacré tous leurs efforts à essayer d’y répondre. Le reportage livre leurs conclusions. Elles sont à la fois lumineuses, inattendues et, hélas, inquiétantes.
« Peser » le vivant, équivaut à un véritable défi. Cela signifie recenser l’intégralité des espèces connues de la flore et de la faune, depuis les plus grands mammifères jusqu’aux plus petits organismes vivants, tels le plancton et les bactéries, et aussi évaluer celles qui nous sont encore inconnues. Puis, de réaliser une opération en apparence très simple, mais en apparence seulement : Calculer le poids moyen d’un spécimen d’une espèce, le multiplier par le nombre de spécimens (ceci donne le poids de chaque espèce), et enfin additionner le poids de toutes les espèces. Une paille !
Mais venons-en directement aux résultats obtenus. Lorsque, dans mon billet précédent, j’évoquais « les chiffres si énormes qu’il est difficile de nous les représenter mentalement, et en tout cas sans qu’ils nous donnent le tournis », cela vaut tout particulièrement pour le cas présent ! Aujourd’hui, le « Poids du vivant » sur terre serait… d’une tératonne ! Eh oui, difficile à « mesurer » n’est-ce pas ? Petit rappel pour les moins matheux d’entre nous : 1 est défini comme 10 puissance 0, 10 vaut pour 10 puissance 1, 100 pour 10 puissance 2,etc. 1 téra vaut pour 10 puissance 12 ! Autrement dit, 1 tératonne équivaut à 1 million de tonnes (ou : 1 milliard de kilos). C’est le poids de la biomasse terrestre estimée à ce jour.
Mais, nos savants « fous » ne comptaient pas en rester là. Ils se sont ensuite demandé : « Comment cette biomasse évolue-t-elle ? ». Retour à leurs planches à calcul, ou plutôt à leurs puissants calculateurs et leurs centaines de… téraoctets. La réponse est tombée, cinglante : la biomasse était, au début de l’ère industrielle, de… 2 tératonnes, exactement le double ! (Et rappelons qu’elle était bien plus considérable il y a seulement quelques millions d’années, autrement dit « une seconde » sur l’échelle de vie de notre planète.) 50% de perte de la biomasse en seulement deux siècles, qui s’attendait à cela ?
Alors, une autre question s’est imposée à eux, démarche typique d’un esprit scientifique et donc curieux : « Quel poids représente le « Non-vivant » ? Autrement dit, tous les objets que l’homme a créés et continue de créer pour son propre mode de vie. Sans surprise, ce poids n’a cessé d’augmenter, et de façon exponentielle depuis le début du XXème siècle. En 2020, il avait rattrapé le poids du vivant et, depuis, il l’a dépassé ! Désormais, nos voitures, téléphones, ordinateurs, trains, fusées… pèsent plus lourd que le vivant, et l’écart se creuse de plus en plus vite. Dans le même temps, les scientifiques responsables de cette étude se sont encore interrogés : « Comment se compose la biomasse ? » « Quelle part de celle-ci est impactée par cette chute exponentielle ? »
Une fois de plus, la réponse s’est avérée particulièrement inquiétante : en 2020, le vivant se répartissait entre : 34% d’humains, 60% de flore et d’animaux domestiques, et seulement 6% de faune sauvage. Les espèces animales sauvages comme, les batraciens, les insectes, les reptiles, les oiseaux, les poissons et les quelques rares grands mammifères que l’homme n’a pas encore abattus, ne représentent plus que 6% de la vie sur terre. La chance que nos enfants aperçoivent ces animaux en dehors d’un zoo, d’un livre ou d’un programme virtuel, s'amenuise d'année en année.
Selon nos savants, toutes ces réponses, vont dans le même sens, celui d’une nouvelle grande extinction. La définition d’une « grande extinction » (ou extinction de masse) est : un événement relativement bref à l’échelle des temps géologiques (quelques millions d’années au maximum) au cours duquel au moins 75 % des espèces animales et végétales présentes sur la Terre et dans les océans disparaissent. Ce serait bien le cas ici.
La terre a connu 5 extinctions de masse dans son histoire :
Cette 6ème extinction de masse, annoncée par nos scientifiques, et qui porte atteinte à la biodiversité terrestre, relève, elle, d’une cause parfaitement identifiée et nouvelle : l’activité humaine et la priorité que s’attribue cette espèce sur toutes les autres. En conclusion de l'étude, une dernière question se pose : « L’humain justifie cette priorité par sa conscience et son intelligence. Ne pourrait-il, dès lors, mettre celles-ci à profit pour stopper l’extinction qui est en cours ? ». Publié le 25/09/2022
Un nouveau « climat » politique en Australie ?
Il est clair que nous sommes sous le feu constant des informations, des bonnes et, surtout, des moins bonnes nouvelles, le tout documenté par des chiffres qui, bien souvent, donnent le tournis. Des chiffres si énormes qu’il est difficile de nous les représenter mentalement.
L’Australie, compte tenu de ses dimensions, est régulièrement l’objet de ces données étourdissantes. En particulier lorsque l’on évoque les catastrophes naturelles dont celle-ci est désormais la victime récurrente. À titre d’exemple, dans mon billet du 29/07/2020, j’évoquais les résultats publiés par les équipes de chercheurs de plusieurs universités, à propos de l’impact sur la faune sauvage, des incendies survenus en début d’année (115 000 km² de terres détruits) : « Leurs résultats font état non pas de un, mais de TROIS MILLIARDS d’animaux tués ! Pour la grande majorité des reptiles (presque 2,5 milliards ont disparu), des oiseaux (180 millions), des mammifères (143 millions) et de nombreuses espèces de batraciens (plus de 50 millions). L’étude n’a pas encore été menée sur la flore, mais les données à ce sujet ne peuvent être que pires encore ». Et de préciser : « Il s’agit là d’un bilan partiel, qui ne prend pas en compte les animaux ayant survécu, mais condamnés à court terme, faute d’habitat, de nourriture, et à la merci de nombreux prédateurs ». Difficile, n’est-ce pas, de se représenter un tel carnage. Aujourd’hui, nous savons que ce sont en réalité 5,8 millions d'hectares de forêt qui ont été détruits dans les seuls incendies de fin 2019 et début 2020.
Un rapport gouvernemental publié il y a quelques semaines insiste sur la gravité de la situation dans le pays et démontre que la faune et la flore uniques de l’Australie sont plus que jamais menacées en raison des feux de forêt, de la sécheresse, de l’activité humaine et du réchauffement climatique. Selon les scientifiques, auteurs de ce document, les millions d’hectares de brousses et de forêts partis en fumée depuis 1990 ont entre autres impacté les forêts vierges, qui représentent des écosystèmes uniques au monde, et aussi plus de sept millions d’hectares (entre 2000 et 2017) servant d’habitat à des espèces menacées. La liste de celles-ci vient ainsi de s’allonger avec 200 espèces végétales et animales d’importance nationale… en cinq ans seulement. Le rapport précise : « L’Australie a perdu plus d’espèces de mammifères que n’importe quel autre continent ». Pendant ce temps, l’expansion urbaine constante contribue à l’augmentation des températures, et à la pollution, tout en puisant sans aucune modération sur les ressources en eau et en énergie. Ainsi, la seule ville de Sydney a perdu plus de 70% de sa végétation indigène à cause de son expansion. En mer, le blanchiment massif des coraux sur la Grande barrière se poursuit. Après les importants dégâts enregistrés en 2016, 2017 et 2020, le même phénomène s’est reproduit cette année.
Croyez-le ou non, mais ceci est un très court résumé. La liste des dommages est bien trop longue pour être exposée dans son intégralité. Mais toujours pas assez longue pour obliger les responsables australiens (et ceci est vrai pour leus homologues à l'international) à agir en conséquence ?
Déjà à l’époque, je me montrais très critique envers Scott Morrison et son gouvernement, pour leur inaction en matière de climat et, pire, pour avoir favorisé plusieurs projets contraires aux objectifs souhaitables en matière de préservation de l’environnement. Non seulement les incendies mentionnés ci-dessus ont perduré (précédés et suivis de graves inondations, liées elles aussi au dérèglement climatique), mais ils ont affecté gravement le trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Dans le même temps, les combustibles fossiles comme le charbon et le gaz sont restés un atout maître pour l'économie australienne, nourrissant le débat au sein des représentants du peuple australien. Nombre de ces derniers refusent de sacrifier une telle manne économique et vont jusqu’à remettre en cause le lien entre catastrophes naturelles et la gestion climatique de la planète.
Mais un espoir vient de naître : l’Australie a choisi de se doter d’un nouveau gouvernement. Exit Morrison et les ultra-libéraux ; le nouveau Premier ministre australien, le travailliste Anthony Albanese, bien que peu populaire, a su convaincre les électeurs avec ses promesses en matière sociale et écologique. Et… il semble décidé à les tenir ! (Ce n’est pas si fréquent en politique). Son gouvernement de centre-gauche vient de faire adopter son projet de loi sur le changement climatique (le premier vrai projet depuis plus de dix ans), définissant des objectifs d'émissions carbonées et inscrivant pour la première fois dans sa législation l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. (Ce à quoi Morrison s’était toujours refusé). Cette loi vise à réduire de 43% les émissions par rapport aux niveaux de 2005 !
Voilà une nouvelle positive et encourageante pour l’ensemble de la planète, et elle mérite d’être soulignée. La flore et la faune australienne doivent être préservées, et tous les efforts en ce sens sont les bienvenus. Publié le 24/09/2022
In memoriam… Ray Bradbury
Suite à mon récent billet (22/08/22) sur le 40ème anniversaire de la disparition de Philip K. Dick, j’entends déjà les puristes de la littérature SF s’indigner de tous les grands auteurs que je n’ai pas cités à cette occasion (Edgar Rice Burroughs, H. G. Wells, George Orwell, Aldous Huxley, Barjavel…). Qu’ils veuillent bien me pardonner et comprendre que la liste aurait alors forcément été longue, sans garantie pour autant d’être exhaustive (les points de vue, et par conséquent la reconnaissance de certains auteurs étant discutables, puisque discutés). À mes yeux l’indignation serait cependant justifiée pour l’un de ces auteurs, et pas des moindres, dont l’œuvre est mondialement connue et pour qui 2022 figure également comme date anniversaire de décès (condition logique et nécessaire pour figurer dans cette chronique). Je veux en l’occurrence parler de Ray Bradbury, disparu à l’âge de 91 ans, le 5 juin 2012… il y a juste 10 ans !
Son cas est toutefois complexe, puisque, contrairement à son confrère Dick, Bradbury reconnaissait n’être attaché à aucune réalité scientifique dans son œuvre, et ne pas même être un auteur de SF, mais de « fantastique ». Pour preuve, un propos tenu par lui en 1999 : « Avant tout, je n’écris pas de science-fiction. J’ai écrit seulement un livre de science-fiction, Fahrenheit 451, fondé sur la réalité. La science-fiction est une description de la réalité. Le fantastique est une description de l’irréel. Donc les Chroniques martiennes ne sont pas de la science-fiction, c'est du fantastique ».
Malgré cet aveu, un Prix Ray-Bradbury est remis chaque année par l’association d’auteurs américains de SF : Science Fiction and Fantasy Writers of America, pour récompenser une œuvre de création cinématographique ou télévisuelle, théâtrale, radiophonique, voire, désormais, diffusée sur internet.
L’œuvre de Bradbury est quant à elle extrêmement prolixe. En effet plus fictive que scientifique, elle pose subtilement nombre de questions sur le sens de la vie, l’existence humaine et, de fait, son devenir. Il est ainsi intéressant de noter comment, avec Philip K. Dick, la technologie et son évolution servent de révélateurs de l’âme humaine, tandis que Bradbury, en faisant fi de la science, se sent encore plus libre de pénétrer l’esprit humain jusque dans ses fantasmes de conquête de l’espace. Nul doute que c’est précisément cette variété d’auteurs, de styles et de propos, qui fait la richesse de la littérature SF.
À lire et à relire : Chroniques martiennes (1950) Denoël Un remède à la mélancolie (Nouvelles) (1950) Folio SF Farenheit 451 (1953) Denoël Publié le 21/09/2022
« Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 Suivant » |
 |
||