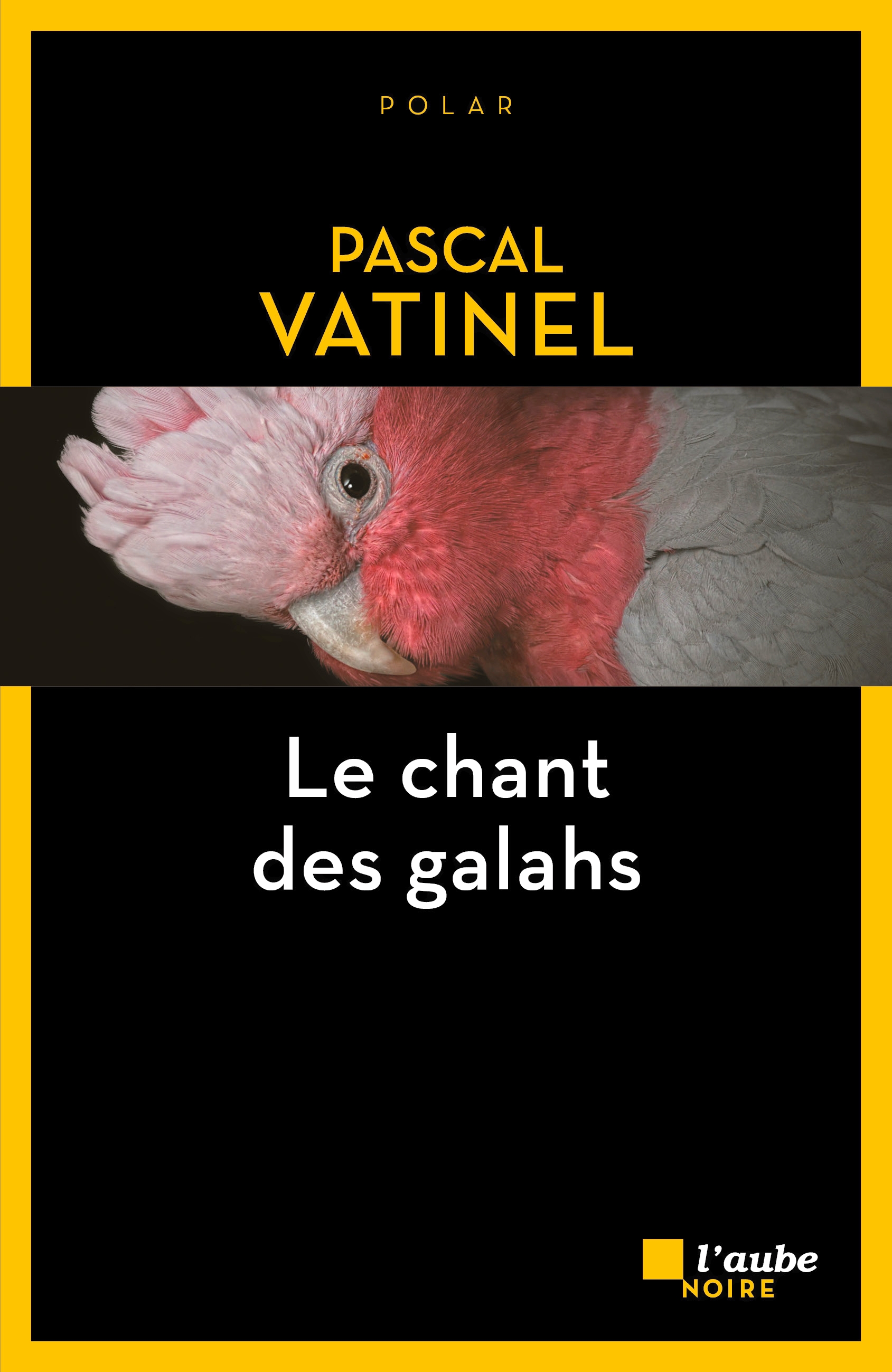|
36 Quai des Cévennes... Festival du Polar
Du 27 au 29 novembre prochain se tiendra au Vigan le Festival du Polar intitulé « 36, Quai des Cévennes ». Petits déjeuners débats, tables rondes, projections de films, conférences, signatures d’ouvrages… autant d’activités pour satisfaire les amateurs du genre !
Je suis invité pour les trois jours et pourrai ainsi (enfin) présenter mon dernier polar : Le chant des galahs.
La très belle librairie de Montpellier, La Géosphère, (spécialisée dans les ouvrages de voyages et de belles aventures humaines) est partenaire du festival et présentera la plupart de mes ouvrages.
Les autrices Claire Raphaël et Hannelore Cayre participeront également à ce bel événement.
NB : J’ai évité l’emploi du conditionnel, mais organisateurs comme invités sommes tous conscients de l’épée de Damoclès que la Covid 19 continue de faire peser sur ce projet. Alors, d’ici là : croisons les doigts ! Publié le 23/09/2020
Le Premier ministre Scott Morrison est-il Amish ?
Un intérêt (ce n’est évidemment pas le seul) du court texte de Simon Leys, publié dans le billet précédent, est d’induire que l’Australie est une terre sur laquelle "l’homme n’a aucune pertinence, où il est superflu". L’histoire récente et même l’actualité de ce pays ne peut que lui donner raison, et tant pis si le propos passe pour misanthrope.
En effet, que deviendrait l’Australie sans les Australiens, en particulier les plus influents d’entre eux, dont le Premier ministre, Mr Scott Morrison ?
Au moment même où…
- Airbus travaille à faire voler ses prochains appareils à l’hydrogène avec l’objectif de contribuer ainsi à réduire l’impact de la pollution due à l’aviation (1) (1) encore faudra-t-il que la production de l’hydrogène nécessaire satisfasse elle-même à des impératifs écologiques
- aux quatre coins de la planète, se tiennent une foultitude de réunions sur l’environnement, le climat et les énergies propres
- le rapport du GIEC (2019) rappelle que : « Rester sous la barre des 1,5 degré de réchauffement réclame d’atteindre l’équilibre carbone vers 2050. Ce qui laisse moins de 30 ans pour avoir remplacé de manière complète des combustibles fossiles qui représentent environ 80 % de nos ressources énergétiques. »
- l’Australie, ravagée par les incendies, les inondations, la pollution des airs et des eaux, prend conscience du rôle du réchauffement climatique dans les phénomènes météorologiques extrêmes
… Morrison vient d’annoncer qu’il était essentiel de relancer l’économie du pays en misant à fond sur… le secteur gazier !
"Joignant le geste à la parole", il a présenté un plan contenant de multiples projets allant de la construction de gazoducs, de centrales au gaz, d’exploitation de nouveaux gisements, en pratiquant notamment la fracturation.
L’Australie est devenue le 3ème pays exportateur de combustibles fossiles (dont le charbon et le gaz), derrière la Russie et l’Arabie saoudite, et pourrait bientôt, grâce à ces projets, gagner encore une place, voire deux !
Ce faisant, et imitant sans doute son modèle américain, Donald Trump, Morrison ne tient aucun compte des avis des scientifiques qui l’entourent et/ou font autorité dans le pays. Ainsi, l’Australia Institute a émis de sérieux doutes sur l’impact desdits projets pour restaurer l’emploi, et considère que l’exploitation des réserves gazières triplera les émissions de gaz à effet de serre de la planète. Il ne tient pas davantage compte de l’avis de nombre d’économistes et de scientifiques qui misaient eux sur une « relance verte », allant ainsi dans le sens de la majorité de la population australienne désormais inquiète des proportions prises par le réchauffement climatique. Pour ces derniers, il est plus que temps que l’Australie développe les énergies propres, très minoritaires aujourd’hui, alors que le continent bénéficie du taux d’ensoleillement par km² le plus élevé de la planète.
Peut-être faut-il demander à M. Macron si Scott Morrison ne serait pas un Amish de la production énergétique ? Publié le 22/09/2020
L'ange et le cachalot
Pacifiste convaincu, les tensions qui se renforcent aux quatre coins de la planète (cf. billet du 18 septembre : Possible conflit armé entre Chine et USA ?) ne sont pas pour me réjouir. Tout particulièrement lorsqu’elles opposent la Chine et l’Australie (aujourd’hui à la limite de la rupture diplomatique), deux terres chères à mon cœur et qui occupent mes pensées depuis plus de 40 ans.
Ce sentiment douloureux et inquiet, il me semble qu’un homme au moins le partagerait si, par bonheur, il était encore de ce monde aujourd’hui. Il s’agit de Pierre Ryckmans, alias Simon Leys, talentueux auteur Belge, sinologue émérite, et professeur australien (il avait la double nationalité : belge et australienne) tout aussi émérite.
Mais je me garderai bien de tomber dans le piège de ceux qui, à titre d’exemple, encensaient Confucius après sa mort (sans nécessairement voir d’analogie entre celui-ci et notre ami belge), par crainte, comme l’analysait si justement Leys, de pratiquer la « glorification » : le hisser sur un piédestal, l’encenser et en faire un dieu… autrement dit de lui ôter toute réalité, tout esprit vivant, et conduire à l’oubli de l’homme qu’il était.
Je me contenterai par conséquent de dire que j’éprouve pour Leys une très grande affinité. Sans jamais la moindre tentation d’espérer un jour l’égaler dans ses divers talents (ni, ce serait pire, l’imiter), je me reconnais dans son écriture, la plupart de ses analyses sur la Chine (si nombreux sont les sinologues, si peu me paraissent connaître la Chine), son goût de la littérature, son affection probable pour l’Australie. Je n’ai qu’un seul regret, n’avoir jamais eu la chance de le rencontrer pour partager avec lui sur nos goûts communs et, bien mieux encore, sur nos différences de vue. Ce regret est toutefois tamisé par l’idée que si j’avais dû choisir entre découvrir l’homme et découvrir son œuvre, j’aurais sans hésiter opté pour son œuvre.
C’est d’ailleurs en redécouvrant son amusant (et en même temps profond) L’ange et le cachalot (Ed. Seuil), empli de ses points de vue sur la littérature (de Balzac à Lawrence, en passant par Malraux et Simenon) et, bien sûr, la Chine et l’Australie, qu’un passage (pages101-104) a tout particulièrement retenu mon attention et éveillé le désir de le partager à travers cette rubrique.
Il s’agit d’un extrait du chapitre consacré à DH Lawrence et son mondialement célèbre roman Kangaroo (Kangourou).
Avant de nous apprendre que le roman de Lawrence, présenté par son auteur lui-même comme une fiction (sans doute pour protéger sa vie) relatait des faits on ne peut plus réels sur l’extrême-droite australienne, Leys nous offre un excellent synoptique du livre ainsi que ce qui se présente comme... le propre sentiment de Simon Leys sur l’Australie. Ces quelques pages ont été pour moi source de stupeur. Les voici :
<< Quand Lawrence aborda en Australie, il n’était assurément pas le premier explorateur littéraire de ce continent. Les plus anciennes apparitions de l’Australie en littérature relèvent du mythe et de l’hallucination, comme il convient pour une terre dont, même aujourd’hui, les habitants ne paraissent pas entièrement convaincus de sa réalité. ../.. ../.. Durant tout le XIXè siècle, les témoignages des visiteurs et des colons anglo-saxons sur le paysage australien reflètent un malaise, voire même une sorte d’effroi inarticulé, qui frappe d’autant plus que ce sentiment n’était pas le fait d’individus particulièrement impressionnables ou imaginatifs. Le paradoxe est que, sans recéler de dangers évidents ni d’animaux féroces, la nature australienne leur semblait respirer une bizarre menace. Car c’est ici un monde à l’envers – et le renversement des saisons n’est que l’indice extérieur de quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Le climat est apparemment clément, mais on n’y meurt pas moins de faim et de soif ; la pays paraît riant – et il est radicalement stérile et inhospitalier ; on dirait une sorte d’immense verger ouvert et ensoleillé – et on s’aperçoit que les arbres n’y portent que des fruits ligneux, de repoussantes poires de bois. Les sempiternels eucalyptus, monotones, omniprésents, perdent leur écorce en toute saison ; ce sont de lamentables arbres en haillons, et leur feuillage couleur de poussière ne donne aucun ombrage. La faune est inoffensive, mais tellement grotesque qu’elle en devient presque sinistre : de qui la Nature se moque-t-elle avec des inventions aussi absurdes que le kangourou et l’ornithorynque ? Et les wombats patauds, et ces lourdauds d’opossums bruyants et asthmatiques qui vous réveillent la nuit, comme ils trébuchent sur les tôles du toit, de leur pas incertain d’ivrogne ? Dans le vide de la forêt, les jacassements des cacatoès, les explosions d’hilarité frénétique et imbécile des Kookaburrahs rieurs ressassent une exaspérante et lugubre plaisanterie d’où l’homme est exclu, et qui vient souligner son exil. Le paysage est informe : est-ce l’effet d’une usure extrême ? Ou au contraire la création encore balbutiante vient-elle à peine de commencer ici, à tâtons ? Les pionniers blancs étaient prêts à courageusement s’empoigner avec la Nature, mais leur défi retombait à plat, il ne rencontrait qu’une colossale indifférence sur laquelle leur énergie demeurait sans prise. Et même aujourd’hui, les grandes villes modernes qu’ils ont bâties de façon incongrue, en lisière de l’immensité sans âge, semblent à peine moins fragiles et dérisoires que les abris des aborigènes nomades dont, pendant plus de cinquante mille ans, la trace légère n’a jamais fait qu’érafler un instant la poussière des déserts. L’horreur inexprimable des premiers colons s’enracinait dans une intuition profonde : dans un monde d’une étrangeté aussi radicale, l’homme n’a plus aucune pertinence, il est superflu. Et en effet, le visage de l’Australie, c’est celui que présentait la Terre avant l’apparition de l’homme, et c’est aussi celui que retrouvera la Terre quand l’homme aura disparu. >> [Le soulignement de ce dernier passage est de mon fait : une des rares phrases de ce court propos avec laquelle je me sens en plein accord, et qui explique précisément mon attachement viscéral à cette terre lointaine (Terre de van Diemen comprise :).]
Ma stupeur, à la lecture de ces quelques lignes, se mesure à l’aune de mon affinité - exprimée plus haut - envers Leys. En effet, à chaque appréciation négative de sa part, s’oppose un souvenir de bonheur, une sensation de pleine satisfaction de la mienne. Là où il voit laideur, j’ai vu beauté ; là où il exprime son malaise, je situe mon bien-être ; quand il relate un effroi dû à une menace voilée, indéfinie, bizarre, et une Nature pourtant sans dangers, je n’ai vu au contraire que Nature aux dangers bien réels, objectivement identifiés. Je ne pourrais me lasser des tableaux magnifiques qu’élaborent les troncs d’eucalyptus (dont il existe en plus tant de variétés), des rires des Kokaburras, des chants d’oiseaux (là encore : des centaines de variétés. Cf : mon Carnet de voyage n°2 sur la Tasmanie), de l’infinie diversité de la faune et de la flore, jusqu’à s’émerveiller, s’interroger, sur le processus même de la création lorsque l’on découvre, en effet, l’ornithorynque ou le thylacine (du moins les rares photos prises du vivant de ce dernier). Point de Nature grotesque, sinistre ou absurde. Pas plus que de sentiment d’exaspérante et lugubre plaisanterie.
Nous voilà donc, Leys et moi, aux antipodes à propos de ce continent. Est-ce, de sa part, un parti pris d’auteur ? la recherche d’une expression poétique ? une suite d’expériences personnelles insatisfaisantes ? le point de vue d’un « intellectuel » ? (Aucune de ces hypothèses n’a, de ma part, vocation à traduire mépris ou péjoration : Leys a un point de vue - c’est parfois mieux que de n’en pas avoir - et il l’exprime, ce qui est de fait respectable.) Mais comment expliquer nos regards aussi antagonistes pour un continent sur lequel nous avons tous deux, cela paraît évident, apprécié de séjourner ?
Il me semble que de tels lieux impliquent, lorsque l’on désire les rencontrer (et donc autrement qu’en simples touristes), à se préparer à un profond et sublime renversement. Ce n’est pas par hasard si l’autre nom de l’Australie est Down-under (auquel Leys lui-même fait allusion dans son commentaire) ou si (à propos de la Chine) l’on a laissé longtemps courir la fable de ces Chinois qui vivent la tête en bas. Il s'agit d'un renversement de nos valeurs, de nos repères, qui oblige à nous déshabiller, en particulier de nos atours intellectuels, et de pénétrer nus et modestes dans la réalité profonde de ces (nouveaux) mondes.
Disons-le tout net : de la même manière, mon attachement à la beauté, la biodiversité, l’infinie aventure que représente l’Australie à mes yeux et à mon cœur, pourrait bien ne passer que pour une simple satisfaction béate devant l’exotisme qu’appelle parfois la langueur monotone d’une vie citadine. Ce n’est pas important. Il n’est nul besoin de trancher ici.
Je suis de toute façon reconnaissant à Leys d’avoir peut-être apporté (à son insu) un éclairage intéressant sur plusieurs commentaires que j’ai reçus à propos de mon récent roman « australien », Le chant des galahs.
Des lecteurs qui me remercient pour ce voyage auquel je les ai invités et ont (je promets que c’est eux qui le disent) aimé ce récit, mais qui ont aussi précisé que l’Australie décrite dans le livre leur a fait un peu peur, les a « inquiétés » ; leur a paru dure et inhospitalière. Il se pourrait, par conséquent, que ma « satisfaction béate » devant la nature profonde australienne n’ait pas trop transpiré dans mon écriture ni altéré l’image que chacun peut se faire de ce pays.
Je garderai en tête, quoi qu’il soit, que pour Simon Leys comme pour moi : « le visage de l’Australie est celui que présentait la Terre avant l’apparition de l’homme, et c’est aussi celui que retrouvera la Terre quand l’homme aura disparu. » Publié le 20/09/2020
Conférence sur la Grande Muraille
Bonne nouvelle pour ceux que le sujet intéresse, et bien sûr pour moi : ma conférence du 10 novembre à St Brieuc est (pour l'instant) maintenue ! Dans le cadre du cycle "Chemins entre Chine et Occident", nous traiterons cette fois de la Grande Muraille, en dressant un état des lieux de nos connaissances et des découvertes les plus récentes la concernant. Ce sera aussi l'occasion de tenter ensemble de résoudre un Quizz de 12 énigmes subsistant à son sujet.
Malgré tout, cela reste un mince espoir, compte tenu de l'évolution actuelle de la pandémie Covid 19. Aussi, pour être certain de ne pas vous déplacer inutilement, mieux vaut vous renseigner au préalable à l'adresse suivante :
Contact : cheminsetcultures@yahoo.fr Publié le 18/09/2020
Possible conflit armé entre la Chine et les USA ?
Interrogé par un lecteur sur la question d’un possible conflit, initié en Mer de Chine méridionale, entre les USA et la Chine, j’ai tenté de lui adresser une réponse synthétique mais qui reste forcément non exhaustive, vu que je ne possède pas, hélas, de boule de cristal.
J’ai choisi de partager cette réponse avec tous ceux qui visitent ces pages.
Il est clair, et cela légitime la question, que la tension dans cette partie du monde est montée de plusieurs crans au cours des dix dernières années, au risque même de déclencher un conflit mondial. Cela me renvoie d’ailleurs à mon dernier séjour à Shanghai, où le couple de Chinois qui me logeait avait pour habitude d’allumer sa télé dès le moment du petit-déjeuner, laissant les infos matinales se dérouler en boucle. Une bonne partie de ces news traitait des démonstrations de force et des provocations récurrentes entre navires chinois, vietnamiens, japonais, américains… qu’ils soient civils (bateaux de pêche) ou militaires. Au bout de quelques jours, j’ai vu l’inquiétude m’envahir tant ces images étaient toutes de violence à peine contenue. Le ton de voix « patriotique », souvent criard, des commentateurs se félicitant de la « bravoure » de leurs marins et fustigeant les « bandits étrangers » y contribua sans doute un peu. Aucun espoir d’une analyse très objective à attendre de leur part, pas plus que sur les chaînes japonaises ou américaines, Fox News en tête.
Alors, à quoi devons-nous cette tension dramatique qu’il est impossible de ne pas prendre au sérieux ? Au plan de la Chine elle-même, plusieurs raisons s’imposent :
Ce simple résumé, concernant les positions de la Chine, apporte déjà une réponse à la question de savoir si une guerre est possible au plan mondial. La réponse est oui : une guerre commerciale, et elle est déjà largement commencée !
Mais quid d’un conflit armé ?
Nombre de commentateurs ces derniers mois reprennent volontiers la théorie développée par l’auteur Graham Allison. Pour justifier l’idée selon laquelle la réussite commerciale chinoise devrait probablement aboutir à un conflit armé avec les USA, l’analyste américain invoque le Piège de Thucydide. Il fait ainsi référence au conflit qui opposa Athènes à Sparte, dû au refus de cette dernière de perdre son hégémonie face à une Athènes en pleine expansion. À l’image de Sparte, les USA sont résolus à conserver leur (discutable) place de 1ère puissance économique et celle (avérée) de 1ère puissance militaire.
La tentation pourrait être grande pour les Américains de profiter, tant que cela est encore possible, de l’écart qui demeure sur le plan militaire entre eux et la Chine. Car, y compris près de ses côtes, et malgré ses efforts, ses lourds investissements, ses progrès fulgurants, la Chine n’est toujours pas « Maître en sa demeure », en particulier en ce qui concerne sa flotte militaire.
En outre, les USA savent pouvoir compter sur ses alliés de la puissante "Alliance des Five Eyes" : (USA), Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, très marquée « antichinoise ». Mieux vaudrait en effet, pour ceux-ci, échapper à un autre piège, celui connu par les armées allemandes contre la Russie lors de la Seconde Guerre mondiale. Indépendamment de l’environnement, un autre facteur déterminant a joué en faveur des Russes : le fait que les Allemands aient sous-estimé la puissance industrielle soviétique et sa capacité à rattraper son retard et même dépasser son ennemi en un temps record ! Il est indubitable que la Chine dispose de cette même capacité à dépasser tous les records, surtout lorsque la situation l’exige.
Il peut être intéressant aussi de se poser la question de l’Europe (hors Royaume-Uni, cela va de soi). Quel camp celle-ci pourrait-elle choisir face à ce conflit militaire potentiel entre les deux premières puissances mondiales ? Les prises de position récentes de l’UE en rapport avec la guerre économique dans laquelle sont plongés les trois grands blocs, et en particulier les conflits de plus en plus nombreux qui opposent la Chine et les « Five Eyes » (5G, affaire Huawei, droits douaniers, accusations réciproques d’espionnage, accusations liées à la Covid 19, etc.) nous donne quelques éléments de réponse, sinon une certitude.
L’Europe a été habituée aux lourds investissements que la Chine a réalisés sur son territoire depuis 2008 et jusque récemment (ceux-ci ont sensiblement été réduits depuis 2016). L’inquiétude provoquée, souvent de façon irrationnelle, ainsi que les cas de conséquences économiques et sociales (réellement) dommageables, ont été largement repris par la presse et commentés auprès de l’opinion publique. En peu de temps, la Chine est devenue un « danger », quand ce n’est pas un « ennemi à abattre ». Mettant ainsi en évidence qu’au jeu désormais nécessaire du Soft Power, l’Empire du Milieu n’a pas su égaler les USA. Quoi que fassent ces derniers contre l’Europe, ils restent les « alliés de cœur ». La Chine, malgré de sincères efforts, n’a pu en faire autant. Ses investissements sont vus comme une volonté d’asservir l’Europe par la dette, capter des savoir-faire, et favoriser une sortie des capitaux de Chine, lui permettant à terme d’imposer sa monnaie contre le dollar. Dès lors, l’endiguement de la Chine apparaît désormais aux yeux de divers pays de l’UE comme une priorité stratégique. La différence avec les USA est que, contrairement à Trump et à ses conseillers, ouvertement décidés à en découdre militairement, l’UE garde espoir de maintenir le dialogue pour éviter le pire. Étrange retour vers une histoire pas si ancienne. Publié le 18/09/2020
Cachons toute honte derrière le masque
Dans la série « Le monde tourne-t-il encore rond ? », je découvre une étude très intéressante portant sur l’efficacité des masques (type FFP2) distribués à nos soignants. Il apparaît que la forme de ces masques n’est pas bien adaptée aux visages féminins, et encore moins si ceux-ci sont asiatiques ! Or, qu’un masque soit bien adapté est encore plus important que son pouvoir de filtration. Les masques en question conviennent à 95% des visages masculins, mais à 85% seulement des visages féminins. De la même façon, si le visage est caucasien, le masque sera bien adapté dans 90% des cas, mais pour les visages asiatiques, cela ne sera plus que 84% des cas. Ainsi, les soignantes d’origine asiatique n’ont que 60% de chances en moyenne d’avoir un masque adapté !
Il serait peut-être temps que les fabricants prennent en compte cette donnée. Quelque chose me dit en effet que ces femmes préféreraient bénéficier d’un équipement correct, efficace, davantage que de recevoir des « médailles » ou des salves d’applaudissement !
Mais, que l’on se rassure : la société Vuitton a peut-être la solution ! Elle lance en effet, à l’occasion de sa collection Croisière 2021, un écran protecteur facial garni de clous dorés et du logo gravé de la marque, pour le tout petit prix de 1 100€. Une version FFP2 de luxe est-elle envisageable ? Après tout, cette société a l’habitude de s’enrichir avec la clientèle féminine asiatique, non ? Je me demande toutefois quelle sera la part de prise en charge par les services sociaux, et le « reste à payer » de nos chères soignantes ?
Comme dit l’adage : « Il faut bien que tout le monde vive » ! Certes, mais apparemment pas avec les mêmes moyens ni les mêmes chances. Je crois d’ailleurs savoir que le même groupe Louis Vuitton, dont l’appétit insatiable et les ressources infinies lui ont permis « d’avaler » la vieille et prestigieuse société Guerlain, envisage de lancer très prochainement un gel hydro alcoolique… parfumé, pour ses chères clientes. J’imagine déjà la queue d’infirmières, aides-soignantes, sages-femmes, dentistes, kinés, médecins, etc... devant les magasins Guerlain pour acquérir leur petit flacon contenant 15 cl de gel, pour le modeste prix de… oui, au fait combien ? 100, 150, 200 euros ? Allons, de telles belles idées n’ont en fait pas de prix ! Publié le 16/09/2020
Rio Tinto… toujours sur la bonne voie ?
Dans mon billet du 25 août dernier (Une bonne nouvelle pour l’Australie), j’évoquais la suppression des bonus du Directeur Général (Jean-Sébastien Jacques, un Français) et de deux hauts dirigeants du groupe Rio Tinto Australie. Une décision prise par le PDG du groupe et son conseil d’administration, suite à la destruction par explosifs d’un site aborigène sacré, vieux de plus de 46 000 ans.
Les trois mêmes dirigeants viennent à présent d’être « démissionnés ».
« Ce qui s’est passé à Juukan est une faute et nous sommes déterminés à faire en sorte que la destruction d’un site patrimonial d’une importance archéologique et culturelle aussi exceptionnelle ne se reproduise plus jamais lors de nos opérations », a déclaré M. Thompson, le PDG de Rio Tinto.
Le Conseil des propriétaires terriens aborigènes (NNTC) a déclaré : « Nous espérons que cela enverra un message fort à l’ensemble du secteur minier: vous devez rejoindre le 21ème siècle et commencer à prendre au sérieux votre gestion environnementale et sociale », précisant que ces licenciements constituaient une étape cruciale, mais qu’il ne s’agissait que de la première d’un véritable processus d’engagement.
Rio Tinto a des activités minières sur pratiquement tous les continents : en Australie (minerai de fer, charbon, aluminium), aux États-Unis (cuivre, charbon), au Canada (aluminium et autres), en Amérique latine et en Afrique du Sud, et même en Europe. Elle est une des quatre premières sociétés minières au monde. Le moins que l’on puisse dire est que ses activités, jusque très récemment, étaient loin d’être vertueuses à l’égard de l’environnement et, surtout, des populations locales. Un revirement dans son éthique serait donc plus que bienvenu.
Pour la petite histoire, rappelons que Rio Tinto doit son nom au fleuve éponyme situé en Espagne. Un site que le groupe exploitait à la fin du 19ème siècle, alors qu’il était le premier producteur mondial de cuivre. Or, ce cours d’eau est devenu rouge (« Rio tinto ») à la suite d’une effroyable pollution due à la dissolution des molécules de fer, cuivre et autres minéraux dans l'eau, provenant des gigantesques mines à ciel ouvertes du secteur.
Rio Tinto étant un groupe anglo-australien, et le Pays d'Oz recelant encore beaucoup de richesses, il sera important de continuer d'observer les activités du groupe dans les prochaines années. Publié le 11/09/2020
Écocide, grandeur… Nature !
Peut-être aurez-vous prêté attention au rapport que vient de publier le WWF à propos de la disparition des espèces vivantes sur notre planète ? Peut-être aussi, l’aurez-vous jugé catastrophiste ? Comme vous, je préférerais des nouvelles un peu plus réjouissantes. Pourtant, je vais davantage enfoncer le clou : loin d’être alarmiste, cette étude est en réalité encore trop optimiste ! Voici pourquoi :
Donc, en 50 ans, (1970-2020) l’humanité aura favorisé la destruction de près de 90% de la biodiversité animale. À l’échelle de l’histoire de notre planète, cela équivaut à une véritable explosion nucléaire. Nombre de ces espèces disparues vivaient sur terre depuis des millions d’années. Évidemment, ayant perdu toute capacité à prendre du recul (comme à voir à long terme), la plupart d’entre nous raisonnent à l’échelle de notre vie (pas même celle de nos enfants et de leurs éventuels descendants). Du coup, le phénomène passe davantage inaperçu. Et puis, il n’est pas autant visible selon les régions où nous habitons : la biodiversité animale a fondu à hauteur de 95% dans les zones tropicales d’Amérique centrale et latine.
Personne (sauf ceux qui, sans doute mieux placés pour comprendre la portée du drame, préfèrent défendre le concept des zoos) ne semble réaliser qu’une espèce disparue l’est… pour toujours !
Nous semblons transporter partout avec nous nos problèmes de « territoires occupés » et de mauvais voisinage. La destruction des habitats naturels pourrait être évitée, ou en tout cas fortement limitée. Seulement, cela nous obligerait à repenser notre approche de l’élevage, de l’agriculture, et reconsidérer en profondeur nos modes de consommation (pas seulement alimentaire). Cela fait plus de 30 ans que ces questions sont posées, débattues, contestées, défendues ; que des discours sont prononcés, des promesses électoralistes faites, sans qu’aucun gouvernement ne se décide à agir.
La suprématie que l’homme impose sur le reste du vivant est une dérive insupportable. Est-il possible que notre seul espoir de la voir s’éteindre repose dans le risque de pandémies dues aux contacts entre humains et derniers animaux sauvages ? Est-ce du catastrophisme de penser que cet écocide « explosif » auquel nous nous livrons ne pourra qu’aboutir à la fin d’une certaine humanité, sinon à la disparition de l’espèce humaine ? Publié le 10/09/2020
« Précédent ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Suivant » |
 |
||